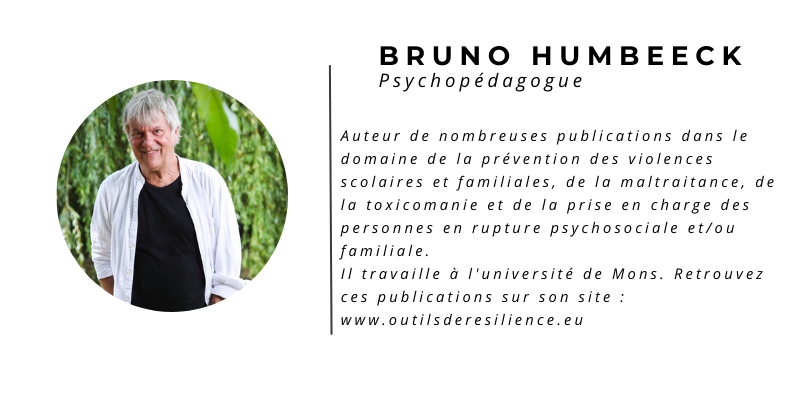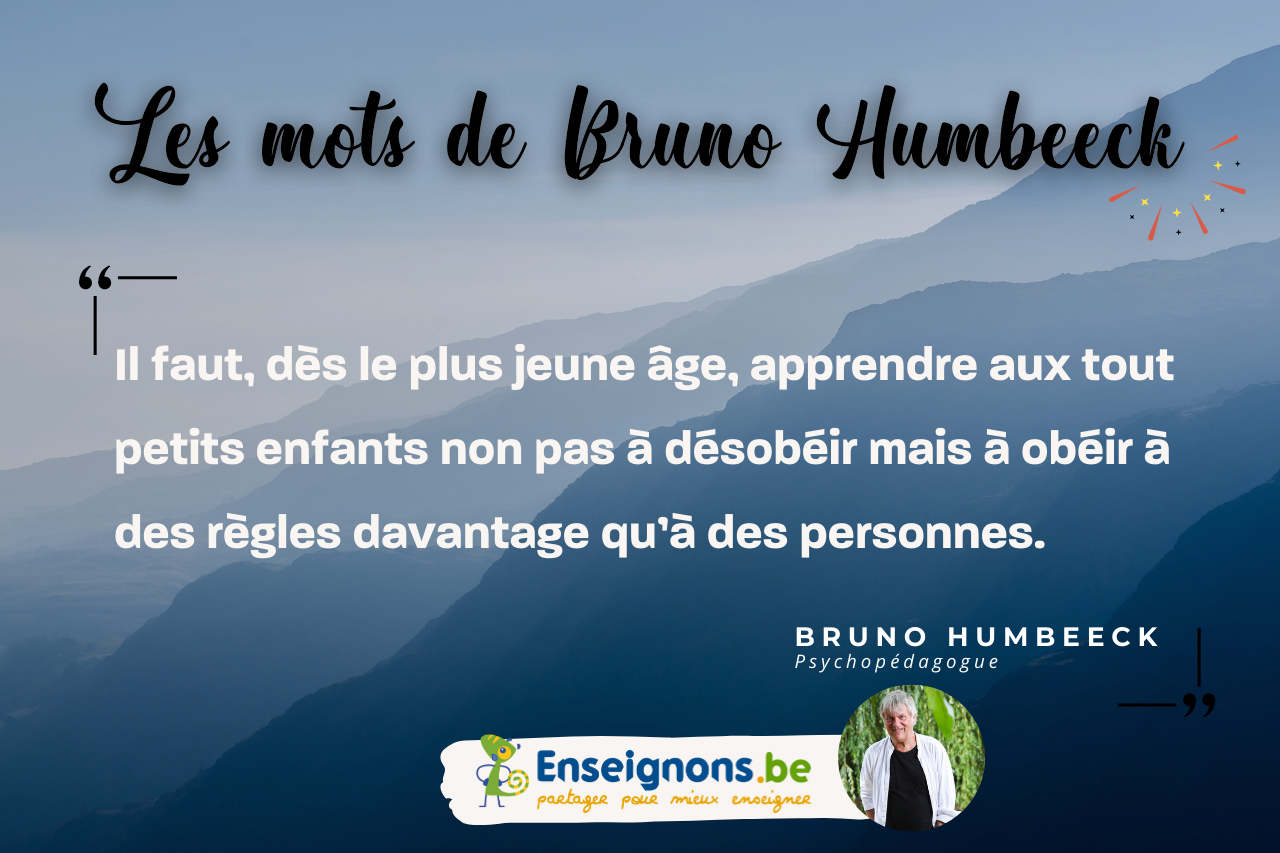Les mots de Bruno : Quand l'école n'atteint plus l'esprit
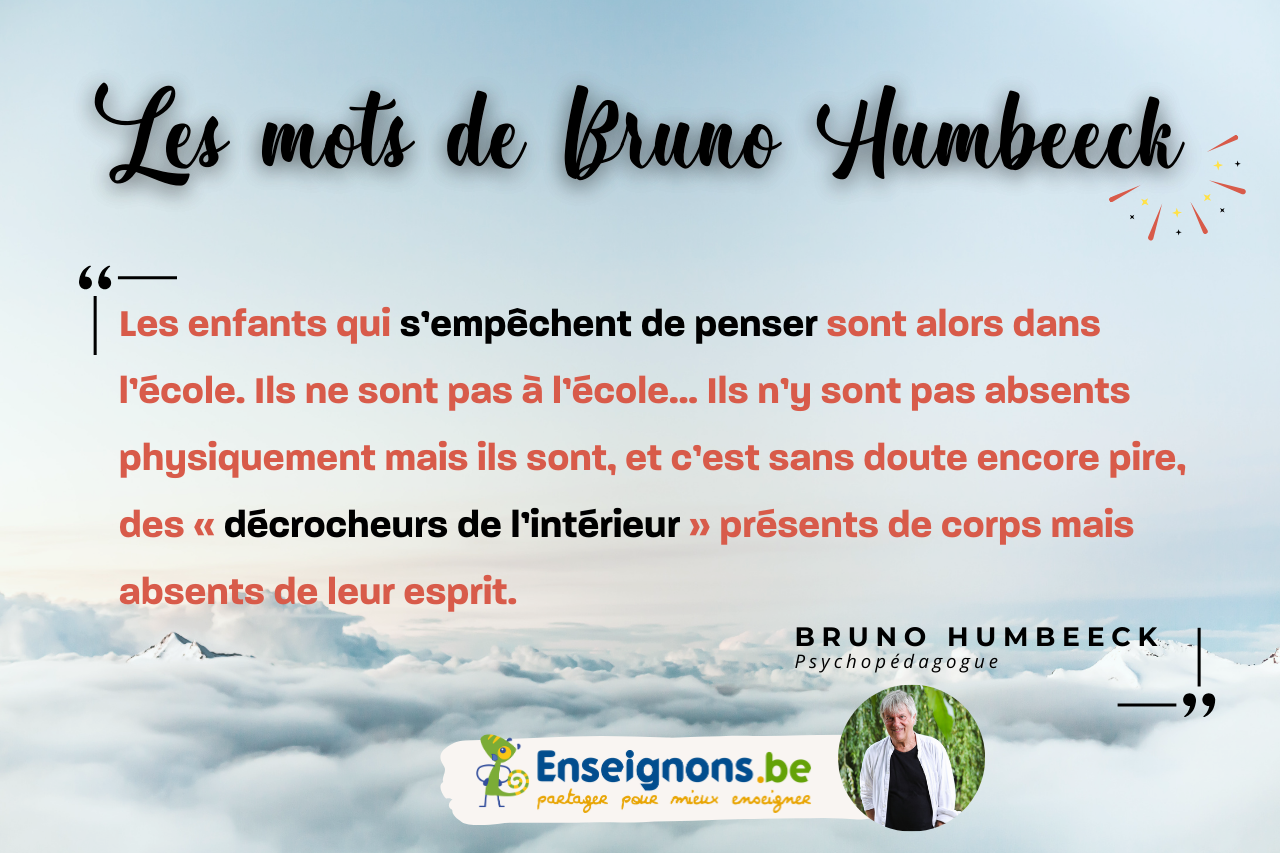
Beaucoup d’enfants, lorsqu’ils se sentent « décrochés », se mettent en situation de s’empêcher de penser.
Les stratégies qu’ils ont à leur disposition pour s’empêcher de penser sont multiples : la passivité ou, au contraire, la vivacité excessive, les troubles de l’attention, l’opposition ou le suivisme, la rigidité mentale ou l’inhibition de la créativité.
Tout est bon pour nourrir l’état d’empêchement de penser dans lequel l’élève décroché se réfugie, soit pour ne pas se laisser envahir par l’anxiété qu’il ressent en ayant l’impression de lâcher prise par rapport au groupe, soit pour ne pas se laisser engluer dans l’angoisse qu’il éprouve à l’idée de ne plus être en mesure de comprendre quoi que ce soit de ce qui lui est donné à apprendre en classe.
Les enfants qui s’empêchent de penser sont alors dans l’école. Ils ne sont pas à l’école... Ils n’y sont pas absents physiquement, mais ils sont – et c’est sans doute encore pire – des « décrocheurs de l’intérieur », présents de corps mais absents d’esprit.
Pour ces élèves-là, tout l’enjeu de la pédagogie consiste à enrichir et sécuriser leur monde intime afin qu’ils trouvent la force de relancer une « machine à penser » qui, parce qu’ils se sont sentis déstabilisés par des apprentissages qu’ils ne considéraient plus à leur portée, s’est complètement enrayée.
Voilà pourquoi on fait de la pédagogie : parce qu’on ne supporte plus l’idée de voir des enfants s’empêcher de penser.
Et voilà sans doute pourquoi on fait de la pédagogie une passion... Parce que l’on se souvient avoir été, un jour, cet enfant qui s’empêchait de penser et qu’il a suffi, un autre jour, qu’un enseignant juge cet enfant suffisamment digne de découvrir le monde pour qu’il lève définitivement cette interdiction de penser et, depuis, ne s’arrête plus de le faire, y trouvant un plaisir infini...